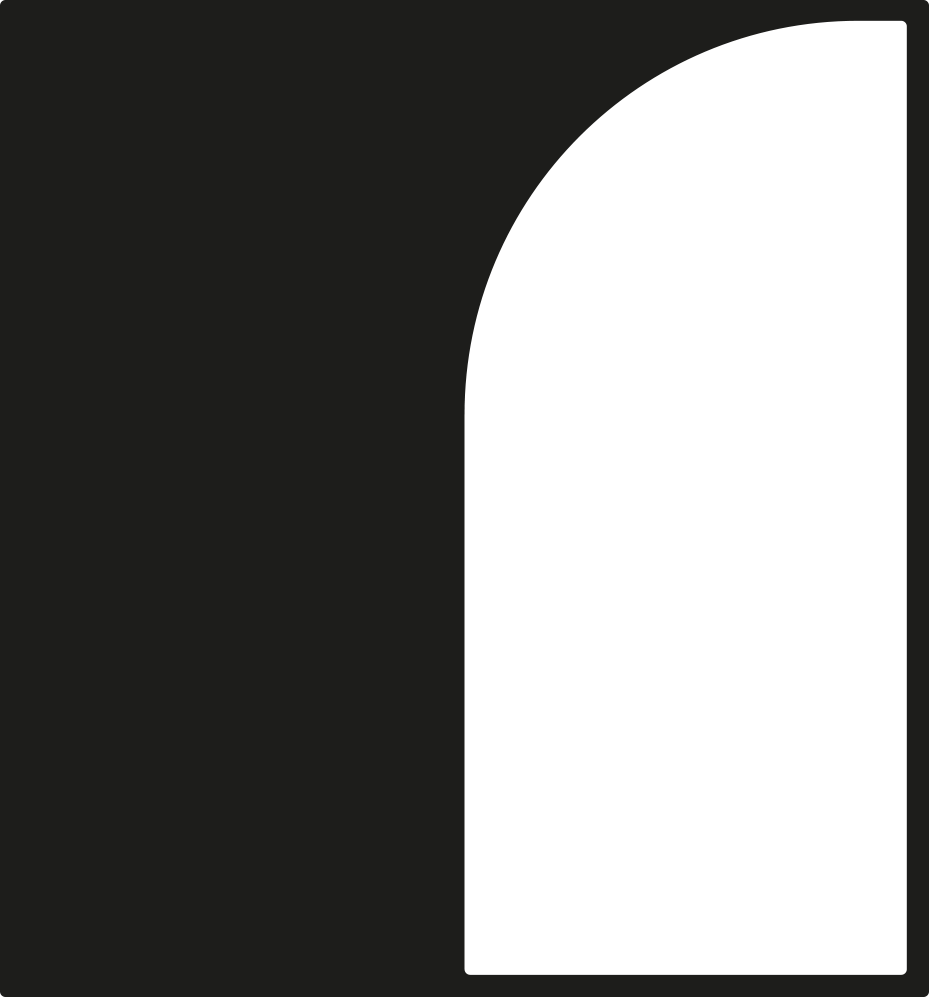TEXT
En découvrant il y a quelques semaines l’exercice olympique auquel s’attelait Edgar Sarin, soit peindre cent peintures en cent jours, j’ai pensé qu’il y avait là le sujet d’une fable ou d’un conte. Le personnage principal n’en aurait point été le peintre, mais sa production : « Il était une fois cent petites peintures… » Voilà comment cela aurait dû commencer. Ces tableautins autonomes me semblèrent au premier abord résolument du côté de la fantaisie, tant technique qu’imaginative, au sens noble du terme pour un peintre, c’est-à-dire celui que lui a donné Fragonard par exemple. Chaque peinture avait l’air de parler à sa voisine avec sa personnalité propre, certaines un peu gauches, timides, d’autres sûres d’elles, frôlant l’arrogance ; elles se scindaient naturellement en familles et me semblaient constituer une formidable société pour ce conte sans âge. Il est vraisemblable qu’Edgar Sarin les considère lui aussi comme des êtres avec qui discuter et qui lui donnent du fil à retordre autant que du plaisir. Toutefois, au fil des jours, la réalisation des peintures avançant, il est apparu que l’atmosphère des contes de fées ne leur siérait point tout à fait. L’affaire est plus sérieuse qu’il n’y parait. Les cent peintures d’Edgar Sarin ont plutôt le caractère et la nonchalance des Nouvelles en trois lignes de Félix Fénéon. En guise de faits divers, de brefs événements visuels ont eu lieu sur des surfaces, et le peintre s’est promis d’en archiver la trace, aussi pragmatique que poétique.
C’est un répertoire intime que Sarin dévoile à travers ces cent peintures, un répertoire de gestes fugaces. À l’étage inférieur de FORMA, les études de Matisse et de Gauguin dans l’exposition Le bonheur de vivre évoquent ce moment où l’œuvre est laboratoire et où tout est encore permis afin que le tableau s’élabore. Le peintre y laisse l’événement advenir, avec une dose de précision mais sans jamais trop de méticulosité. Edgar Sarin m’a un jour décrit ses cent peintures comme autant de « tubes à essais ». Pourtant toutes sont aussi achevées que les grands formats montrés lors d’expositions passées. Nul ne peut prédire si chacun des cent tableaux donnera un jour naissance à un autre développement. Peut-être qu’au contraire, de grandes peintures antérieures ou des sculptures sont à la genèse de ces petites synthèses picturales. À quel moment passe-t-on de l’état de fragilité embryonnaire de l’étude à la solidité du tableau fini ? Quand arrêter l’expérience ? Selon Sarin, les peintures ont chacune acquis un état d’achèvement à partir du moment où elles ont incarné la résolution d’un problème. Ce dernier est généralement d’ordre technique, il concerne la main et il n’est pas forcément perceptible par quelqu’un d’autre que le peintre lui-même. Il est question de coup de pinceau avant tout, de touche, de brosse, de transparence, de superposition, de matière, d’assèchement, de relief ou de son absence, de vitesse.
De ce répertoire de gestes émerge un autre vocabulaire, celui de formes reconnaissables : les dents de scie de certaines sculptures, ou dans les Danses macabres, des pieds empruntés à une icône d’Andreï Roublev, mais aussi des Fruits indéfinis empilés en pyramide comme on réarrange les billes du billard avant de commencer la partie. Ou encore un soleil vert, des fragments d’une lampe Tahiti d’Ettore Sotsass, des Paysages variés qui s’offrent comme des méditations. Puis quelques étrangetés ici et là : une petite toile est traversée par la comète de Halley de la tapisserie de Bayeux, elle a pris la direction inverse par rapport à son modèle d’origine. Un tableau nommé Amphore revêt des allures de couronne, il est le seul à être réalisé à la colle de peau de lapin. La peinture à l’huile a pris ensuite le relai, prescrite par la rapidité d’exécution, sur toile ou sur bois, avec plus ou moins d’épaisseur et de variation dans les formats. La palette des cent peintures est réduite et les teintes semblent avoir été introduites au fur-et-à- mesure que la série progressait, l’opus précédent contaminant chromatiquement le suivant. Les cent peintures, accrochées à touche-touche et un peu de guingois invitent à une déambulation le long des murs. À chacun de développer son plan-séquence. Elles seront ensuite tout autrement perçues dans leur isolement.
De petites émotions surgissent. (En réalité, ce sont de grandes émotions mais on a envie dans cette exposition de tout qualifier de petit, avec toute la sympathie qu’engage le terme). Certains ciels s’agitent quand d’autres sont aussi lisses qu’une mer d’huile, la lune peut être indolente ou violente (avez-vous jamais contemplé une lune violente ?), le paysage doux ou anarchique. États d’âmes ? La question est ailleurs, elle concerne la peinture davantage que le peintre. Des petits miracles adviennent à la surface du tableau, des échecs aussi, des salissures et des encrassements, des repentirs et des reprises. Pendant ce temps, des motifs s’échappent, fuient le cadre. Mus par des mouvements internes, les tableaux gardent une distance avec l’échelle anthropomorphique et une forme de mutisme avec le spectateur. Le seul homme évoqué a des allures de pantalon d’Ubu plus qu’autre chose. Comment entrer dans ces détails – car les cent peintures sont-elles autre chose qu’un ensemble de détails ? Point de couteau
prêt à tomber au bord de la table comme chez Chardin, point de logique spatiale stricte dans les paysages, ni de chemin à emprunter. L’aérien partage la scène avec le tellurique. Je retrouve une note prise à l’occasion d’une discussion avec l’artiste : « Pendant longtemps, elles n’ont pas eu de sens. » La désorientation est telle en voyant les peintures, que je ne me souviens pas ce qu’il a voulu dire. Parlait-il prosaïquement d’horizontalité et de verticalité, d’un sens de lecture, ou bien de la finalité de l’ensemble ?
Chacun se satisfera des inévitables références, puisées dans l’histoire de l’art ou ailleurs, que sa mémoire convoquera comme des flashes devant tel ou tel élément. Mais la raison d’être des cent peintures d’Edgar Sarin est assurément à relier à leur processus de création plutôt qu’au résultat final et à ce qu’il évoque. Les cent tableaux sont nés du même flux, grâce à une pratique quotidienne ininterrompue pendant cent jours. À l’atelier, ils étaient littéralement partout, occupant chaque espace libre. L’accrochage dans l’exposition leur donne des allures de cycle, dans la lignée des frises antiques ou des tapisseries médiévales, mais il ne reflète cependant pas la chronologie de la fabrication, celle-ci reste à retrouver ou imaginer. Dans ce flux, les accidents sont légion. Plus encore, ils sont recherchés. L’histoire de l’art est pour Sarin une succession d’erreurs menant à de nouvelles découvertes, comme en cuisine. Si l’on parcourt les murs à la recherche de ces accrocs et de strates, on peut comme un archéologue tenter de remonter le chemin du pinceau et du poignet. Les tableaux sont de manière générale très plats, seuls quelques-uns témoignent d’un surgissement de la pâte, une épaisse couche blanche ou grise surpeinte. Sarin joue avec les manières de traîner le pinceau, les gestes de la grande tradition abstraite se retrouvent miniaturisés pour une réunion de famille. Ce sont ces petits épiphénomènes qui sont le véritable sujet des peintures. En cent jours, Edgar Sarin a réuni une collection de gestes et d’accidents, un patrimoine devant lequel le sujet s’efface. Dans ces graffitis hors du temps, réalisés dans une épique tension entre plaisir, jouissance et contrainte, le naïf ou le primitif peuvent toucher la plus grande sophistication et la poésie la plus pure.
Jean-Marie Gallais